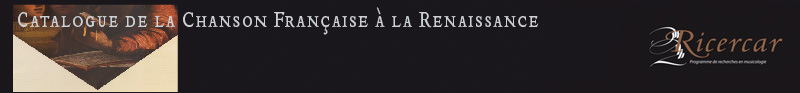
Accueil
Toute recherche sur les sources musicales de la Renaissance étant confrontée à la dichotomie sources manuscrites/ sources imprimées, il est apparu, lors de la constitution de la base, que pour ces dernières existait déjà un outil fort précieux, le catalogue de la chanson établi par Hubert Daschner comme corollaire de sa thèse Die gedruckten mehrstimmigen Chansons von 1500-1600. Literarische Quellen und Bibliographie, soutenue à Bonn en 1962. La démarche initiale a consisté à l’informatiser d’une part, et d’autre part à le compléter et en vérifier les données. Le compléter : très peu de sources manquaient à l’appel, essentiellement les publications de la première décennie de l’impression musicale (Öglin, Schöffer, Antico), les trois recueils identifiés comme [Egenolff c. 1535], et le problématique Trium vocum carmina de Formschneider 15389, dénué de tout texte, même d’incipit. Daschner n’avait pas étendu sa recherche aux psautiers, ce qui explique que ce répertoire – provisoirement – ne figure pas non plus au catalogue ; les psaumes isolés que l’on peut y trouver proviennent donc de recueils de chansons spirituelles ou de livres de « Meslanges ».Enfin y figurent les sources du début du xviie siècle qui trouvent leur origine dans un travail de composition antérieur, comme par exemple les Meslanges de du Caurroy.
Les ajouts structurels ont consisté en l’inclusion d’une part des sources monodiques, puisque la recherche de Daschner se limitait aux sources imprimées polyphoniques, et d’autre part des sources manuscrites. Ces dernières ont donné lieu à de nombreux débats préliminaires. À quelle limite chronologique devait-on se tenir, en reculant dans le temps, pour correspondre à la définition de la « chanson de la Renaissance ? » La parution du catalogue de la chanson du XVe siècle, dû à David Fallows, semblait devoir apporter un début de solution : il apparaissait logique de prendre appui sur sa limite supérieure (c. 1480) pour en faire notre limite inférieure. Certes, mais comment définir avec précision un corpus de sources manuscrites se situant autour de cette période ? Et même dans le cas d’une datation relativement précise de tel ou tel manuscrit, que faire d’une chanson elle-même recopiée d’une source très antérieure, à partir du moment où une liste correcte des concordances nous fait reculer jusqu’au milieu, sinon parfois jusqu’au premier tiers du xve siècle ? Il y avait en l’occurrence conflit de priorité entre deux principes : dépouillement intégral d’une source, ou historique exhaustif d’une unité musicale donnée. La décision finale a été de se couvrir de l’autorité du Census-Catalogue ; toute source polyphonique qui y est affectée de la datation « c. 1480 », et bien sûr au-delà, serait prise en compte et dépouillée intégralement. L’avantage est de pouvoir se référer à une documentation reconnue ; l’inconvénient est de renoncer à dépouiller des sources qui sont probablement contemporaines, et dont certaines entrées sont sûrement plus récentes que les plus anciennes se trouvant dans des sources qui, elles, ont été prises en compte. Par exemple, certaines des entrées de Florence 229 ou de Bologne Q 16 sont assurément plus anciennes que bien des chansons de Dijon 517, ou du groupe de manuscrits provenant du même atelier de copie. Dans des cas tels que celui-ci, la concordance « Dijon » est exceptionnellement notée, mais dans le champ des « remarques » seulement, puisque le principe adopté consiste à ne faire figurer, en source principale ou en concordance, que les unités des manuscrits qui ont été réellement dépouillés. De toute façon, toute information relative à une chanson de cette fluctuante période-frontière doit être complétée par un recours au catalogue de D. Fallows.
À ce propos, là où l’équipe Ricercar pense avoir fait véritablement œuvre utile, c’est dans le dépouillement des sources manuscrites de la période couvrant approximativement les vingt dernières années du xve siècle. De nombreux titres, dans les manuscrits de cette période, peuvent dès maintenant être mis en rapport avec des titres correspondants dans les sources imprimées des deux premières décennies du siècle suivant, et d’autre part avec les deux grandes sources manuscrites monodiques (Bayeux et Paris 12744). Ce travail de rapprochement, largement effectué dans les travaux bibliographiques concernant les compositeurs individuels (Compère, La Rue, Brumel…), n’existait pas pour les anonymes : seule la liste alphabétique globale, telle qu’elle se présente dans le catalogue, le rend opérationnel de façon exhaustive.
En ce qui concerne cette liste, dont l’ordre n’est pas strictement alphabétique mais aménagé en raison de la fantaisie orthographique et lexicale propre à la Renaissance, on se reportera au mode d’emploi qui figure parmi les options proposées lors de l’accès à la base proprement dite, et que l’on a tout intérêt à lire au préalable. On y trouvera d’utiles recommandations (utilisation de la troncature, choix des procédures de recherche, hiérarchie dans les renseignements fournis par la source, etc.).
Toute recherche sur les sources musicales de la Renaissance étant confrontée à la dichotomie sources manuscrites/ sources imprimées, il est apparu, lors de la constitution de la base, que pour ces dernières existait déjà un outil fort précieux, le catalogue de la chanson établi par Hubert Daschner comme corollaire de sa thèse Die gedruckten mehrstimmigen Chansons von 1500-1600. Literarische Quellen und Bibliographie, soutenue à Bonn en 1962. La démarche initiale a consisté à l’informatiser d’une part, et d’autre part à le compléter et en vérifier les données. Le compléter : très peu de sources manquaient à l’appel, essentiellement les publications de la première décennie de l’impression musicale (Öglin, Schöffer, Antico), les trois recueils identifiés comme [Egenolff c. 1535], et le problématique Trium vocum carmina de Formschneider 15389, dénué de tout texte, même d’incipit. Daschner n’avait pas étendu sa recherche aux psautiers, ce qui explique que ce répertoire – provisoirement – ne figure pas non plus au catalogue ; les psaumes isolés que l’on peut y trouver proviennent donc de recueils de chansons spirituelles ou de livres de « Meslanges ».Enfin y figurent les sources du début du xviie siècle qui trouvent leur origine dans un travail de composition antérieur, comme par exemple les Meslanges de du Caurroy.
Les ajouts structurels ont consisté en l’inclusion d’une part des sources monodiques, puisque la recherche de Daschner se limitait aux sources imprimées polyphoniques, et d’autre part des sources manuscrites. Ces dernières ont donné lieu à de nombreux débats préliminaires. À quelle limite chronologique devait-on se tenir, en reculant dans le temps, pour correspondre à la définition de la « chanson de la Renaissance ? » La parution du catalogue de la chanson du XVe siècle, dû à David Fallows, semblait devoir apporter un début de solution : il apparaissait logique de prendre appui sur sa limite supérieure (c. 1480) pour en faire notre limite inférieure. Certes, mais comment définir avec précision un corpus de sources manuscrites se situant autour de cette période ? Et même dans le cas d’une datation relativement précise de tel ou tel manuscrit, que faire d’une chanson elle-même recopiée d’une source très antérieure, à partir du moment où une liste correcte des concordances nous fait reculer jusqu’au milieu, sinon parfois jusqu’au premier tiers du xve siècle ? Il y avait en l’occurrence conflit de priorité entre deux principes : dépouillement intégral d’une source, ou historique exhaustif d’une unité musicale donnée. La décision finale a été de se couvrir de l’autorité du Census-Catalogue ; toute source polyphonique qui y est affectée de la datation « c. 1480 », et bien sûr au-delà, serait prise en compte et dépouillée intégralement. L’avantage est de pouvoir se référer à une documentation reconnue ; l’inconvénient est de renoncer à dépouiller des sources qui sont probablement contemporaines, et dont certaines entrées sont sûrement plus récentes que les plus anciennes se trouvant dans des sources qui, elles, ont été prises en compte. Par exemple, certaines des entrées de Florence 229 ou de Bologne Q 16 sont assurément plus anciennes que bien des chansons de Dijon 517, ou du groupe de manuscrits provenant du même atelier de copie. Dans des cas tels que celui-ci, la concordance « Dijon » est exceptionnellement notée, mais dans le champ des « remarques » seulement, puisque le principe adopté consiste à ne faire figurer, en source principale ou en concordance, que les unités des manuscrits qui ont été réellement dépouillés. De toute façon, toute information relative à une chanson de cette fluctuante période-frontière doit être complétée par un recours au catalogue de D. Fallows.
À ce propos, là où l’équipe Ricercar pense avoir fait véritablement œuvre utile, c’est dans le dépouillement des sources manuscrites de la période couvrant approximativement les vingt dernières années du xve siècle. De nombreux titres, dans les manuscrits de cette période, peuvent dès maintenant être mis en rapport avec des titres correspondants dans les sources imprimées des deux premières décennies du siècle suivant, et d’autre part avec les deux grandes sources manuscrites monodiques (Bayeux et Paris 12744). Ce travail de rapprochement, largement effectué dans les travaux bibliographiques concernant les compositeurs individuels (Compère, La Rue, Brumel…), n’existait pas pour les anonymes : seule la liste alphabétique globale, telle qu’elle se présente dans le catalogue, le rend opérationnel de façon exhaustive.
En ce qui concerne cette liste, dont l’ordre n’est pas strictement alphabétique mais aménagé en raison de la fantaisie orthographique et lexicale propre à la Renaissance, on se reportera au mode d’emploi qui figure parmi les options proposées lors de l’accès à la base proprement dite, et que l’on a tout intérêt à lire au préalable. On y trouvera d’utiles recommandations (utilisation de la troncature, choix des procédures de recherche, hiérarchie dans les renseignements fournis par la source, etc.).
Annie Cœurdevey




